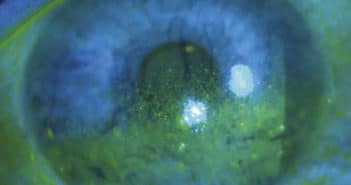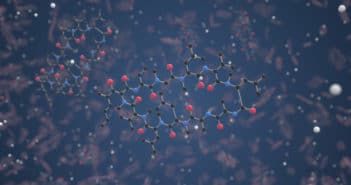Quoi de neuf en surface oculaire ?
Le millésime 2021 de L’Année ophtalmologique est un cru particulièrement riche en nouveautés, tant sur le plan de la compréhension que des traitements des pathologies de la surface oculaire (SO). Nous avons dû, comme toujours, effectuer une sélection (forcément subjective) de quelques publications marquantes qui changent déjà ou pourraient changer nos pratiques. Nous commencerons par aborder le rôle du microbiote dans la physiologie et la pathologie de la SO, et l’utilisation potentielle du microbiote intestinal pour réguler l’inflammation de la SO. Nous évoquerons ensuite les derniers développements des lumières thérapeutiques dans le traitement des dysfonctions des glandes meibomiennes (DGM), puis le développement d’un nouveau spray intranasal pour traiter la sécheresse oculaire et, enfin, les effets oculaires – pour le moins paradoxaux – du dupilumab, un médicament ayant révolutionné la prise en charge de la dermatite atopique.