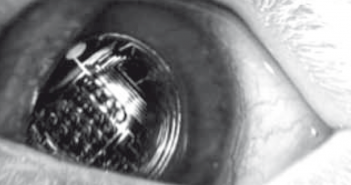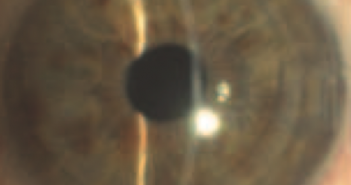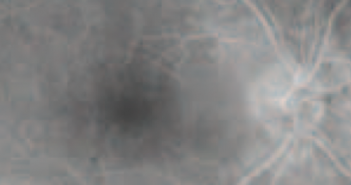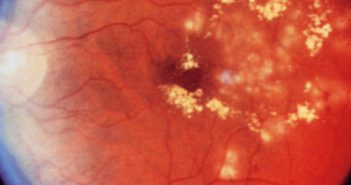Les implants asphériques négatifs ont démontré leur supériorité sur les implants sphériques en améliorant la sensibilité aux contrastes en condition mésopique et scotopique tout en ne dégradant pas l’acuité visuelle de loin. Néanmoins, les études récentes démontrent le compromis nécessaire entre aberration sphérique totale minimisée, sensibilité aux contrastes optimisée et moindre profondeur de champ. Or la profondeur de champ est particulièrement importante chez les patients pseudophaques car c’est par elle que peut être restauré un confort en vision de près. La profondeur de champ de l’œil humain est dépendante de facteurs externes (luminance, contraste de l’objet, fréquence spatiale) et de facteurs internes oculaires (diamètre pupillaire, acuité visuelle, âge, état accommodatif, et bien sûr aberrations optiques du système visuel : aberrations de bas ordre corrigées par la réfraction sphéro-cylindrique et aberrations de haut ordre telles que la coma, le trefoil, l’aberration sphérique). Même si l’instauration d’une bascule myopique sur l’œil dominé permet l’augmentation de la profondeur de champ binoculaire, la tolérance interindividuelle à cette monovision est variable. L’aberration sphérique est responsable d’une défocalisation en avant des rayons passant par la périphérie d’une surface optique. Cette seconde “focale” peut être perçue par l’œil du sujet : l’aberration sphérique constitue donc un des moyens de générer de la multifocalité. Une bascule d’aberration sphérique, sans bascule myopique, optimisée en fonction de la dominance oculaire, semble permettre une optimisation de la profondeur de champ binoculaire sans grever la vision stéréoscopique.