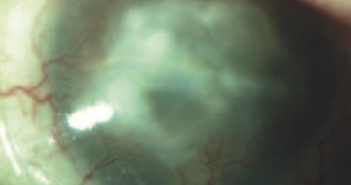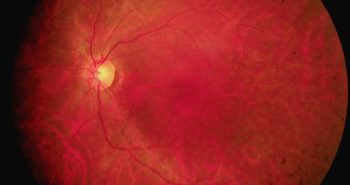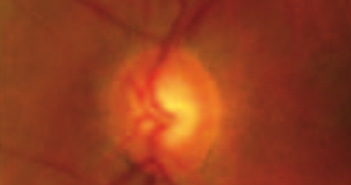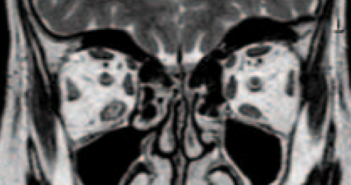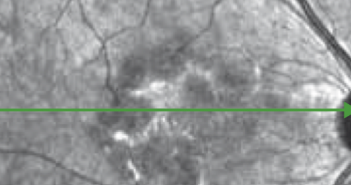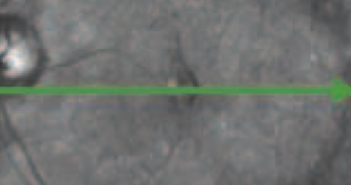De nombreuses stratégies thérapeutiques entrent dans une phase d’expérimentation clinique avec comme objectif l’arrêt de la progression des processus dégénératifs et de la perte des fonctions visuelles. Ces approches permettront certes de répondre à l’attente de la grande majorité des patients, mais pour ceux qui auront atteint un stade très avancé de ces affections, ce ralentissement ou arrêt de la maladie n’aura qu’un retentissement très limité en termes de bénéfice fonctionnel. Le développement des stratégies de substitution ou de restitution fonctionnelles trouve dans ces cas toute sa justification. Les implants rétiniens artificiels entrent dans cette catégorie et un essai clinique a démontré récemment la faisabilité, la sécurité, et leur intérêt sur une trentaine de patients atteints de rétinopathies pigmentaires à des stades très avancés. Des capacités de discrimination visuelle ont pu être restaurées chez des patients à un stade de quasi-cécité grâce un dispositif ARGUS II (Second Sight, CA, USA).