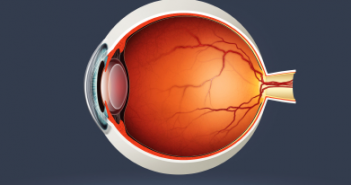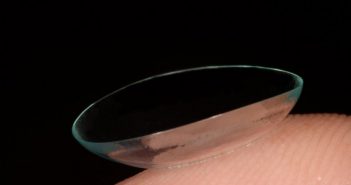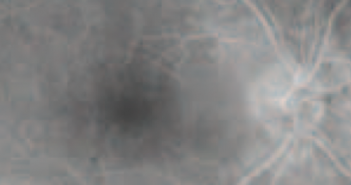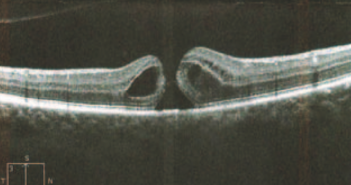Cataracte et uvéite : précautions et techniques
La survenue d’une cataracte chez les patients atteints d’uvéite peut avoir une double origine, liée d’une part à l’inflammation intraoculaire elle-même, mais aussi aux corticoïdes utilisés pour la traiter (cataracte cortico-induite). Parmi ces deux facteurs, l’inflammation non contrôlée est la plus cataractogène.
Toutes causes d’uvéites confondues, la cataracte est une complication retrouvée dans 30 à 40 % des cas selon les séries [1]. Cette valeur est cependant à nuancer selon le type d’uvéite et les complications (uvéites antérieures, aiguës, récidivantes ou chroniques, l’arthrite juvénile idiopathique au premier plan, hautement cataractogène [2]). L’opacification cristallinienne n’est que faiblement liée aux formes postérieures d’inflammation.
La chirurgie de la cataracte chez les patients atteints d’uvéite est désormais de bon pronostic grâce à l’amélioration des techniques opératoires, de moins en moins traumatisantes, et à un contrôle optimal de l’inflammation dans les temps pré- et postopératoires. Ce seront les trois points clefs de la prise en charge d’une cataracte dans un contexte d’uvéite.