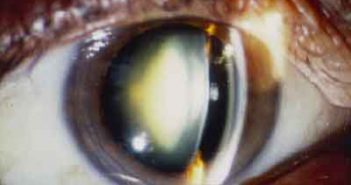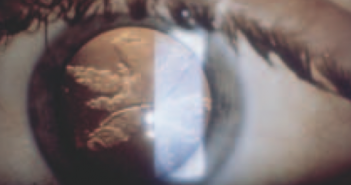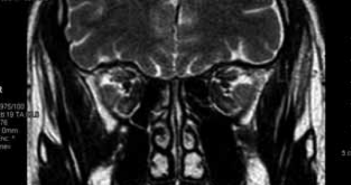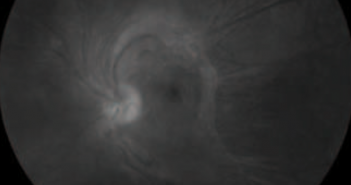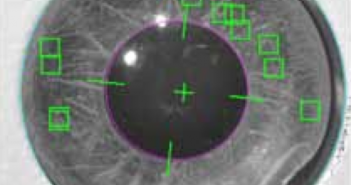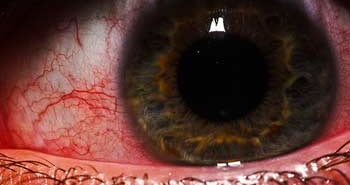
Glaucome et syndrome d’apnées du sommeil
Le syndrome d’apnées du sommeil est une entité complexe susceptible d’entraîner des complications cardiovasculaires non négligeables sur le plan général. Son association à des pathologies ophtalmologiques diverses a été régulièrement décrite ; la relation entre glaucome primitif à angle ouvert et syndrome d’apnées du sommeil n’est pas univoque. Cet article se propose de faire le point sur le sujet et de souligner qu’à l’heure actuelle, la prise en charge du glaucome reposant sur la baisse pressionnelle intraoculaire, il n’en demeure pas moins important de rechercher des facteurs de risque vasculaire éventuellement modifiables pour le bien de nos patients ; l’œil faisant partie du corps humain, on ne peut pas faire abstraction des pathologies générales éventuellement associées.