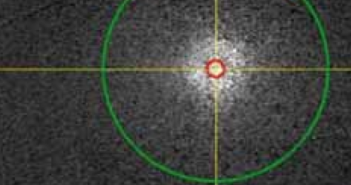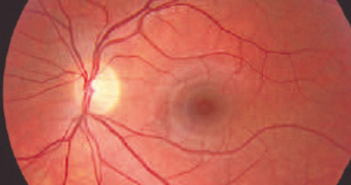Le nystagmus chez l’enfant
Les étiologies d’un nystagmus chez l’enfant sont nombreuses. Le bilan orienté en fonction de la clinique a pour but d’éliminer une cause neurologique ou sensorielle. La démarche diagnostique repose, en premier lieu, sur les caractéristiques morphologiques du nystagmus. Le bilan fonctionnel permet d’apprécier le retentissement du nystagmus sur les performances visuelles de l’enfant. L’indication chirurgicale dépend des caractéristiques cliniques et de la gêne fonctionnelle induite.