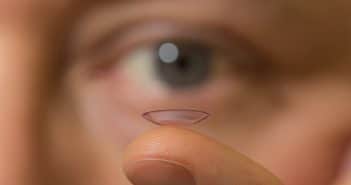Chirurgie des trous maculaires de petit et moyen diamètre : quelle attitude adopter ?
Le développement de la chirurgie vitréorétinienne en ambulatoire, associé à la prise en charge de patients de plus en plus âgés, modifie actuellement les contraintes périopératoires, tant pour le chirurgien que pour le patient. La quête d’une chirurgie “minimaliste” prend alors du sens, tout particulièrement pour la chirurgie du trou maculaire (TM). La mise en évidence des effets secondaires du pelage de la membrane limitante interne (MLI) sur la fonction visuelle amène à limiter son indication. Il est désormais reconnu que pour les trous maculaires de petit et moyen diamètre (≤ 400 µm), un taux de fermeture > 95 % est obtenu sans dissection de la MLI, et sans positionnement “face vers le sol” mais en évitant le décubitus dorsal.