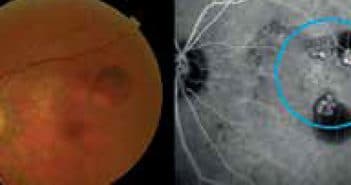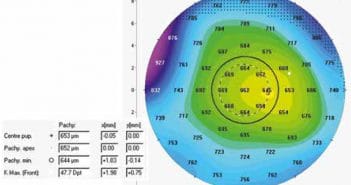Comment s’y retrouver avec les lentilles jetables toriques ?
Les lentilles jetables journalières (LJJ) toriques sont apparues sur le marché en 2002. Depuis, leurs paramètres et le matériau se sont améliorés, mais le silicone hydrogel n’a été décliné en LJJ qu’en 2009, soit pratiquement 10 ans après son apparition pour les lentilles mensuelles. Les indications de ces lentilles sont passées en revue et c’est l’interrogatoire qui permettra de les adapter rapidement au plus près des besoins et des spécificités de chaque patient. La correction de l’astigmatisme est abordée dans ce contexte du “jetable” ainsi que la nécessité de le corriger ou non.