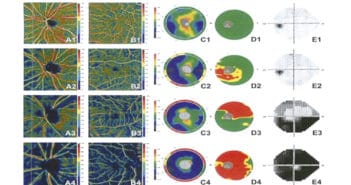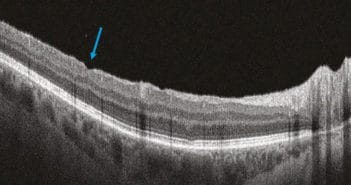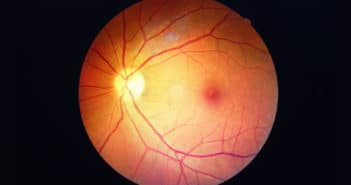La pratique quotidienne de l’ophtalmologiste comprend aussi l’examen de l’enfant, dès la prime enfance ! Le praticien se trouve parfois peu préparé à recevoir le petit, envoyé par le pédiatre ou simplement accompagné par les parents inquiets. Voici quelques conseils et un résumé succinct de pratiques quotidiennes afin de dépister et prendre en charge nos jeunes patients.
À partir de quelques questions de base – quand, comment, pourquoi, quelle correction ? –, nous avons identifié 10 éléments qui sont constants dans la pratique de l’ophtalmologie pédiatrique et que nous utilisons comme support de notre activité courante en cabinet libéral et en clinique. La priorité est donnée aux enfants qui présentent des facteurs de risque et/ou des signes de trouble visuel, ainsi qu’aux enfants envoyés par l’école ou le pédiatre. Il est important à notre avis de les mettre à l’aise et de s’armer d’une bonne dose de patience !
Il faut considérer la réfraction objective aussi bien que la réfraction subjective, quand cela est
possible, et prescrire la correction la plus adaptée en présence de troubles sensimoteurs ou en
présence d’une simple amétropie. Il est aussi important de s’assurer que la correction est montée sur un équipement adapté.