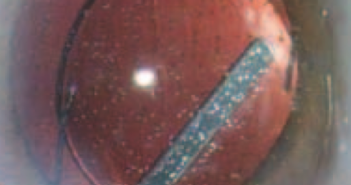Chirurgie réfractive à l’American Academy of Ophthalmology
Comme chaque année, une session de communications orales ayant pour thème la chirurgie réfractive s’est tenue lors du congrès de l’American Academy of Opthalmology 2012, à Chicago. En voici un compte rendu.