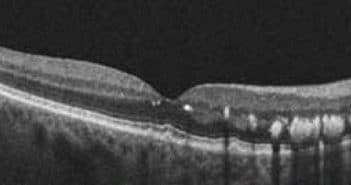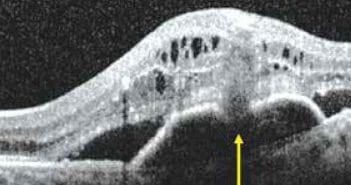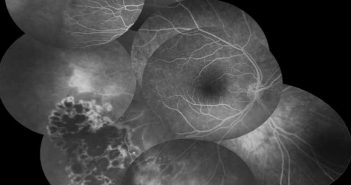Occlusions artérielles rétiniennes : quel bilan pour rechercher quelles étiologies/facteurs de risque ?
Les occlusions artérielles rétiniennes (OAR) sont des urgences ophtalmologiques nécessitant un transfert vers un centre spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Elles se caractérisent par une obstruction du flux artériel rétinien, pouvant être causée par un embole, un thrombus, une vascularite ou un spasme. L’absence d’apport en oxygène à la rétine entraîne une perte de vision sévère dans la zone de rétine ischémique. L’incidence des OAR est de 0,5 à 1,5/10 000 par an. Il n’existe actuellement aucun traitement fondé sur des preuves ayant démontré un bénéfice visuel. La fibrinolyse reste controversée.