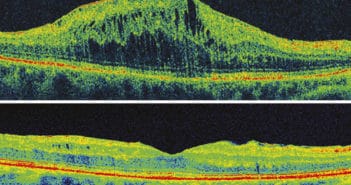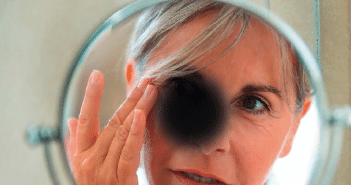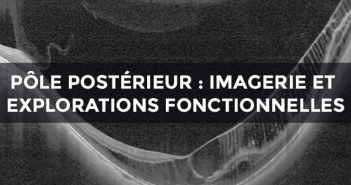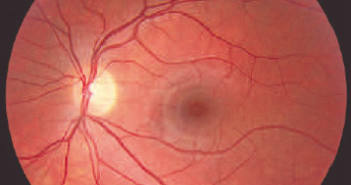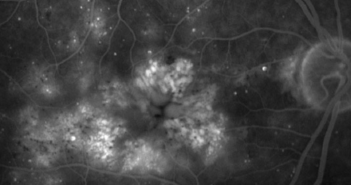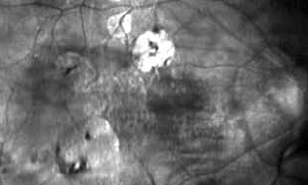Correction de l’aphaquie par implantation secondaire
Il n’existe pas une mais plusieurs possibilités d’implantation secondaire afin de corriger l’aphaquie, notamment en cas de chirurgie de cataracte compliquée. Chacune comporte ses propres avantages et inconvénients, ce qui orientera le chirurgien en fonction de la situation clinique et de ses habitudes. L’innovation chirurgicale constante vise à favoriser l’implantation postérieure et à minimiser les gestes invasifs avec notamment des incisions de taille réduite pour limiter l’astigmatisme induit, tout en apportant un maximum de confort visuel, de sécurité et de pérennité des résultats.