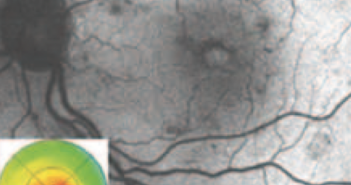Au cours des occlusions veineuses rétiniennes, l’évolution spontanée ou avec traitement de l’acuité visuelle reste difficile à prédire. L’œdème maculaire représente cependant la principale cause de baisse d’acuité visuelle et les anti-VEGF, comme les corticoïdes, ont un effet anti-œdémateux important.
Les études qui évaluent la réponse à ces médicaments, en particulier les études avec tirage au sort et groupe témoin – SCORE pour la triamcinolone, GENEVA pour l’implant intravitréen de dexaméthasone et CRUISE pour le ranibizumab –, sont difficiles à comparer entre elles parce qu’elles concernent des populations différentes et qu’elles sont de conception différente.
En pratique, l’acuité initiale, l’importance de l’œdème, la mobilité du patient et la notion de comorbidités telles qu’une cataracte ou un glaucome sont déterminantes pour le choix d’un traitement ou pour une abstention thérapeutique. La prise en charge correspondra à un risque raisonnable chez un patient donné, en fonction du résultat visuel attendu et avec une contrainte adaptée aux possibilités de ce patient.