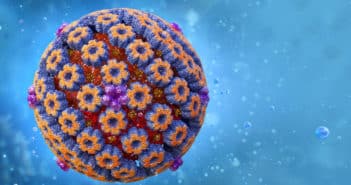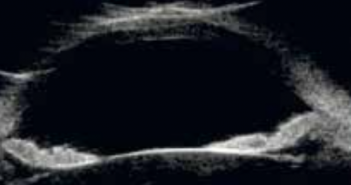Le lymphome intraoculaire primitif : un défi diagnostique
Le lymphome intraoculaire primitif (LIOP), également appelé lymphome vitréo-rétinien primitif, est une forme rare de lymphome non hodgkinien à grandes cellules B, pouvant se compliquer d’atteintes du système nerveux central, menaçant le pronostic vital. Son diagnostic est complexe en raison de l’absence de signes pathognomoniques, de sa présentation clinique variée, et de sa similitude avec les uvéites. Les symptômes principaux incluent une hyalite diffuse et des altérations de l’épithélium pigmentaire rétinien. L’imagerie multimodale (OCT, auto-fluorescence, angiographie) joue un rôle crucial pour identifier des signes évocateurs.
Le diagnostic se fonde sur une démarche codifiée, en commençant par les examens les moins invasifs pour conforter la suspicion clinique et en terminant par les prélèvements les plus iatrogènes. Il repose finalement sur la cytologie, obtenue le plus souvent par vitrectomie, combinée à des marqueurs biologiques. En cas de résultats négatifs, des prélèvements plus invasifs (biopsie rétino-choroïdienne ou cérébrale) peuvent être envisagés après discussion multidisciplinaire. Une surveillance rapprochée est recommandée en l’absence de preuve cytologique. À l’avenir, les technologies d’intelligence artificielle et la biologie moléculaire pourraient améliorer le rendement du diagnostic non invasif. Dans tous les cas, une approche multidisciplinaire est essentielle pour optimiser le parcours et le pronostic des patients.