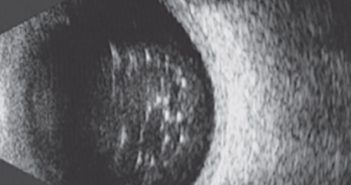Analyse du film lacrymal
L’amélioration progressive des moyens d’imagerie s’est accélérée ces dernières années, notamment dans le domaine de la surface oculaire et du film lacrymal qui restait encore un domaine confidentiel jusqu’à récemment. De nouveaux appareils “couteaux suisse” permettent notamment une visualisation de la couche aqueuse mais aussi lipidique du film lacrymal et des glandes de Meibomius, et évaluent même la qualité visuelle grâce à l’aberrométrie. En conjonction avec l’examen clinique et les questionnaires d’évaluation de la sécheresse oculaire, tous ces éléments permettent à la fois une meilleure compréhension des mécanismes intriqués mais également une meilleure considération des problèmes rencontrés par nos patients et de leur prise en charge.