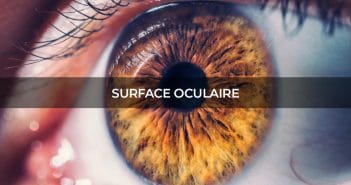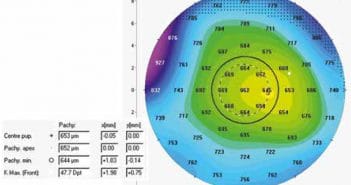Plaies et contusions du segment antérieur
Les contusions du globe oculaire sont très fréquentes et souvent suffisamment bénignes pour ne pas être médicalisées. Les contusions graves ou les plaies du globe sont en revanche plus rares, bien qu’elles représentent un peu plus de 15 % des consultations aux urgences ophtalmologiques. Il est important d’utiliser la terminologie internationale BETTS qui décrit les plaies et contusions, tant pour homogénéiser leur prise en charge que pour établir leur pronostic ou aider le patient dans ses démarches administratives futures.
Dans l’idéal, les plaies et contusions graves font l’objet d’une attitude soignante normée. Elle consiste en une prise en charge de première ligne qui établit le diagnostic, effectue le bilan médical et exploratoire le cas échéant, prépare l’aval immédiat médical ou chirurgical tout en renseignant de manière complète et détaillée le dossier médical. La possibilité d’un corps étranger doit toujours rester présente à l’esprit au cours la chaîne de soin. Malgré un pronostic parfois très réservé, il convient d’entamer une lutte opiniâtre pour préserver autant que possible le pronostic visuel, esthétique ou de confort du patient.