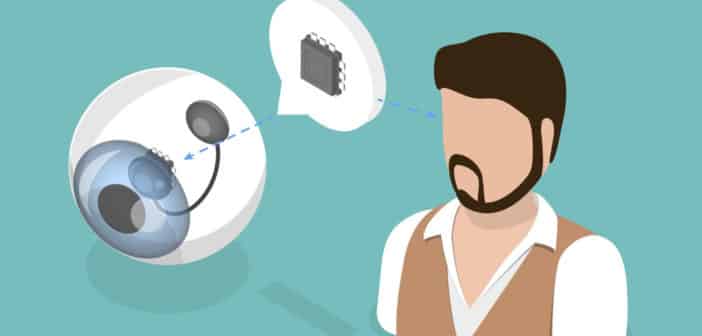Les implants rétiniens ont été développés dans les années 1990 pour compenser la disparition de photorécepteurs dans les dystrophies rétiniennes. Plutôt que d’évoquer une rétine artificielle, il faut donc parler de stimulateurs rétiniens, puisque le rôle de ces implants est de transmettre un signal aux cellules ganglionnaires et, de là, au nerf optique, puis au cortex. Les premières études ont été réalisées sur des patients aveugles par rétinopathie pigmentaire avancée, chez qui il avait été démontré que la stimulation électrique épirétinienne par voie de vitrectomie sous anesthésie locale engendrait la perception de phosphènes de façon reproductible et que deux stimulations provoquaient deux phosphènes. À partir de ces études sont rapidement nés les implants rétiniens de stimulation épirétinienne par Second Sight, développant Argus 1 puis Argus 2.
Toujours dans les années 1990, en Allemagne, un projet fédéral voyait le jour pour financer la recherche sur les implants rétiniens, comparant les possibilités de stimulation épirétinienne, comme celle de Second Sight et de la stimulation sous-rétinienne. Ce plan de financement fédéral a fait éclore plusieurs compagnies, telles Intelligent Medical Implant (IMI), en 2002, pour la stimulation épirétinienne – devenue, en 2013, Pixium Vision en France – et Retina AG pour la stimulation sous-rétinienne ; sans oublier d’autres projets universitaires jamais passés au stade commercial.
Le résultat de cette recherche aboutissait au marquage CE du dispositif de Pixium Vision et d’Alpha-IMS de Retina AG, une dizaine d’autres étant soit en cours d’étude, soit abandonnés. Ces deux implants rejoignaient donc Argus II, de Second Sight, le seul à avoir obtenu à la fois le marquage CE et l’approbation FDA.
Les stimulateurs prérétiniens0
1. Technique
Nous ne parlerons ici que d’Argus II, de Second Sight, le seul stimulateur rétinien ayant été jusqu’à l’approbation par la FDA et à la mise sur le marché ; Iris II, de Pixium Vision (fig. 1), étant de conception voisine, mais n’a jamais été commercialisé.[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire