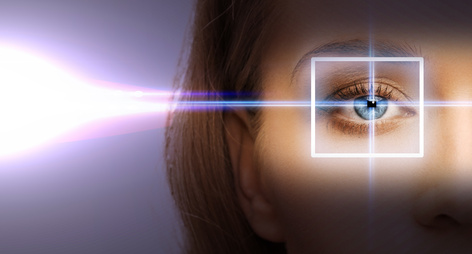La monovision : un concept classique
Le principe de la monovision est assez simple : il consiste à proposer une méthode de correction de la presbytie par la correction d’un œil pour la vision de loin et de l’autre pour la vision de près. Cette méthode peut être appliquée à la correction par lentilles de contact ou par chirurgie réfractive, cornéenne ou implantatoire.
La monovision représente une méthode couramment retrouvée et bien ressentie par le sujet dans la majorité des cas ; son succès peut cependant être limité par trois principaux facteurs : la dominance oculaire, l’obtention d’une bonne vision intermédiaire et l’altération de la vision stéréoscopique.
Sur le plan pratique, il est communément admis que la correction optique sera adaptée pour la vision de loin pour l’œil dominant quel que soit le mode de correction par lentilles de contact, chirurgie cornéenne photo-ablative ou chez le pseudophake [1].
>>> La dominance oculaire, nécessaire dans la recherche du succès de la -monovision, a fait l’objet depuis plus de 50 ans d’expériences et de recherches diverses tant elle semble difficile à caractériser de façon uniforme. Il semble, en fait, que la dominance oculaire est un concept plastique, fluide et susceptible d’une grande adaptabilité [2]. Elle est également inégale d’un individu à l’autre. Il semble sur des observations basées chez les sujets anisométropes soit de manière naturelle, soit de manière induite par les lentilles de contact, que moins la dominance oculaire est marquée, meilleure est l’adaptation à la monovision.
Sur le plan pratique, le choix actuel du test se porte sur la “tolérance au flou” réalisé en interposant une addition de +1,25 à +1,50 D, alternativement, devant chacun des deux yeux et en demandant au sujet devant lequel sa vision binoculaire paraît la plus claire.
Les indications de la monovision sont simples et peuvent être résumées de la façon suivante :
– une motivation clairement exprimée par le patient à ne pas porter de lunettes en postopératoire, notamment lors de chirurgie de la cataracte ;
– et une non-indication d’implant multifocal, soit par le patient, soit par le chirurgien.
L’analyse de la littérature retrouve peu d’études comparant les deux choix d’implantations, la randomisation étant impossible notamment en raison du surcoût engendré par l’implant multifocal [3]. De même,[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire